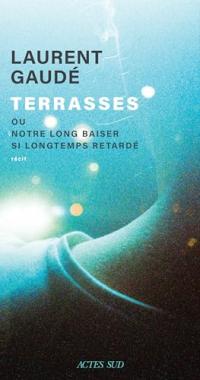
J’ouvre les yeux. Je me dis que cette journée est belle puisque nous allons nous voir ce soir. Je souris à l’idée de ce rendez-vous et sens, dès le matin, cette boule dans le ventre qui dit que je t’aime peut-être plus que je ne le pensais. Une longue attente s’étale devant moi jusqu’à te voir. Aurons-nous le temps de nous aimer ? Je me pré‑ pare. Je veux que tu tombes à la renverse en me voyant et tu tomberas. Je m’habille. Je ne mets pas de soutien-gorge. Puis je change d’avis. J’en mets un en me promettant de l’enlever, plus tard, dans la journée, lorsqu’il sera temps d’aller te rejoindre. Je prends plaisir à imaginer cette fin de journée. Une partie de moi voudrait y être, une autre, que l’attente dure encore. Ce long retardement, de toi à moi, est un délice. Pou‑ voir imaginer ces moments, faire tourner dans ma tête tout ce que je te dirai, tout ce que je te ferai. Je mets mon pantalon large, parce que tu m’as dit un jour que tu aimais la dégaine que j’avais avec. Ce sont tes mots. La dégaine. Tu n’as pas dit que j’étais belle et c’était mieux. La dégaine, c’est le charme et c’est de cela que j’ai envie: te charmer. Comme il sera long d’attendre ce soir. Mais j’aime cette journée qui nous sépare. Je ne sais pas si je suis celle qui t’embrassera ou celle qui sera embrassée, celle qui posera la main sur ton bras ou celle qui recevra ta caresse mais il me tarde d’être face à toi, hésitante et enflammée à la fois. Je me lève moi aussi. Une parmi tant d’autres. Peu importe mon nom, Lisa, Prune ou Leïla. Nous sommes tant. Toutes différentes et si proches. Nous nous levons aux quatre coins de la ville. Jour normal que rien ne désigne si ce n’est ce nom, vendredi, qui le rend aimable. Nous sourions. C’est le dernier jour avant le week-end. Nous avons hâte. Nous nous levons, sans imaginer qu’ils se lèvent eux aussi, dans d’autres lieux de la ville, prennent un café eux aussi, en mangeant peut-être, comme nous, des tartines. Nous n’y pensons pas. Comment pourrions-nous imaginer ? Nous ne savons rien d’eux, ni eux de nous. À cette heure, nous sommes inconnus les uns des autres. Personne n’a de nom. Seul le malheur en donnera un à certains d’entre nous, bien plus tard, lorsqu’il faudra établir des listes. Pour l’heure, nous vaquons à notre vie, simple vie. Nous nous pré‑ parons, sortons, allons travailler, passons des coups de fil que nous jugeons importants, marchons d’un bon pas car c’est le début de la jour‑ née et nous avons mille choses à faire. Le temps est magnifique. C’est étrange en cette période de l’année. C’est pour cela qu’il y aura tant de monde aux terrasses des cafés ce soir, parce que les Parisiens sentent bien que c’est peut-être la dernière soirée douce avant l’hiver et je n’arrive pas à démêler, en mon esprit, si c’est un détail plus cruel encore, comme un piège que le beau temps fait à la jeunesse ou, au contraire, un der‑ nier cadeau de la vie. Nous allons, venons, pris dans la course des jours. Pour l’heure, c’est la vie, juste la vie qui nous entoure. Y a-t-il un bruit que le malheur aurait fait en se levant et que nous aurions dû reconnaître ? Avons-nous raté un signe qui nous aurait alertés et peut-être sauvés ? Bientôt la violence va surgir en sidérant nos prévisions de bonheurs mais, pour l’heure, c’est encore inimaginable. Aucun d’entre nous ne fait rien de bien particulier, ne prend de risque inconsidéré. Nous sommes juste ce que nous sommes.
Vous quittez vos appartements tandis que moi, j’y retourne. Longue nuit de veille. Au chevet de corps qui n’ont plus de force et acceptent nos mains comme seuls témoins de leur faiblesse. Je m’appelle peut-être Gaëlle ou Gloria. Peu importe. Nous sommes si nombreuses. Allons être si nombreuses. Je rentre d’une nuit de garde à l’hôpital Saint-Antoine. J’ai hâte d’être chez moi. Je me ferme aux regards des autres dans le métro. Je suis fatiguée. Je pense simplement aux courses que je dois faire ou à mes filles qui sont à l’école. Si j’ai des filles, oui, il est certain que je pense à elles à cet ins‑ tant. Je suis Véronique ou Babeth. Je prends peut-être un café avec les collègues. Parce que la nuit a été longue et que c’est la fin de la semaine. Peut-être Virginie a-t-elle dû insister, “Allez, les filles, juste un café…”, et nous avons cédé, moi et d’autres. C’est vrai que ça fait du bien, ce petit repos de l’âme. Parler d’autre chose. Se demander en rigolant ce qu’on pense du jeune et fringant nouveau médecin-chef. Ou peut-être suis-je seule ? À une table. Besoin de silence. À moins que je n’aie pressé le pas dès que j’ai franchi la porte de l’hôpital, justement pour ne pas être hélée par une collègue. Parce que j’ai hâte de rentrer pour retrouver l’autre bout de ma vie. Alors, si c’est cela, je suis déjà en train de descendre les escaliers qui mènent aux rames du métro. J’essaie d’oublier les visages que je viens de quitter, ceux des patients du couloir A, bâti‑ ment 4, et pourtant le couloir A ne disparaît pas, pas encore. C’est normal. J’ai l’habitude. Cela prend du temps. Il est là, avec ses portes ouvertes, ses charriots de nourriture, les pieds à perfusion et les lits à roulettes. Il faut encore quelques minutes pour qu’il s’estompe… J’essaie de me concentrer sur autre chose, pour que commence le repos. Je vais de mon travail à mon domicile, comme mille fois auparavant, songeant à demain, à ce que j’aimerais faire dimanche. Et puis je finis par fermer les yeux pour que disparaisse le wagon du métro qui est si lent, si laid… »