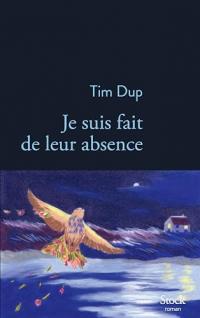
J’adore cette maison. Elle raconte ma famille comme personne ; d’où nous venons, nos enfances, nos miracles, nos aberrations. Roseville-sur-Mer. C’est là que tout s’est joué et que tout se joue encore.
Cet automne, par un curieux jeudi d’octobre, nous avons récupéré la maison avec Victoria. Un chalet en bois, incongru dans ce paysage d’aquarelle normande. À l’intérieur, nous avons éclairci les murs, agencé différemment les pièces, repensé la décoration, l’ameublement, comme une dénégation de la mise en vente, histoire de nous offrir un semblant de chez-nous avant de laisser l’endroit. Vincent, mon oncle, a acheté une nouvelle télé, que nous avons placée avec la bibliothèque, sur le pan opposé au vitrage du salon. Au rez-de-chaussée, il a aussi remplacé les toilettes de la chambre d’amis et le vieux canapé d’angle. Je m’avance devant la vitre du séjour, au bord du porche. Au fond du jardin, les maisons bourgeoises dissimulent la mer à mes yeux jaloux. À l’ouest, par-dessus le muret et la façade des voisins, s’ébauchent tout de même un morceau de marine, l’apparition du ciel et son enclume anthracite, le ressac et la plage brossée par les déferlantes. Les tempêtes se sont rapprochées, ces dernières années. Fataliste, j’attends.
Je me suis levé avec cet engourdissement des mauvais jours, l’humeur hostile, le visage fermé. Toute la nuit, je suis resté sur le dos, tendu, la couette relevée jusqu’à la poitrine, les bras au-dehors, le souffle tiède de Victoria au creux du cou. Noyé dans l’insomnie, j’ai repoussé les draps. Victoria dormait encore. J’ai descendu l’escalier à tâtons. Du couloir de l’entrée, les ombres dansaient derrière la baie vitrée. Dehors, il faisait noir et le bruit des rouleaux se confondait avec celui du vent d’hiver. Les yeux aimantés par la mer, j’ai pensé à ces gens du bout du monde, sur leurs îles prisonnières des barrières de corail, où rien ne semble pleurer, hormis les franges des filaos, ces épineux dont le seul souci est de prendre la courbe du vent. J’envie les hommes sans hiver, qui ne meurent ni de froid ni de faim, ne pensent ni au temps ni à l’épargne. Mais eux aussi traînent sans doute leurs spectres derrière eux…
Ce matin, je goûte une haine encore jamais éprouvée. J’ai de la peine à l’admettre, mais l’appel d’Esther, ma cousine, a fini de m’anéantir. Je pensais être préparé, le mental indéboulonnable, mais quelque chose s’est cassé. Depuis hier, je sens grandir la vibration, longtemps enfouie : la sale envie de péter les plombs. Tout me remonte à la gueule. Esther sanglotait. C’était désarmant, de l’entendre me dire, entre deux respirations, qu’Henri était venu chez elles, avait osé sonner. Sa sortie de prison, nous l’avions acceptée. Mais revenir vers nous, c’est plus que je ne peux supporter.
Je mets plusieurs secondes à prendre conscience que mon café est prêt. Oui, tout me remonte à la gueule. Mon père, ma mère, Roseville. Comment les uns et les autres se permettent-ils d’avoir un avis sur cette maison ? Ma cousine n’y a jamais vécu. Vincent, mon oncle, l’a quittée il y a des années. Toute ma vie est ici, je n’ai qu’elle. Aucune autre fondation, hormis ces murs. S’ils la vendent, je suis foutu. Je sais bien ce que le reste de la famille en pense : ils n’en peuvent plus de cette baraque, ils aimeraient la voir tomber, brûler, que ses cloisons se fissurent, se brisent et fassent déguerpir les fantômes qui s’y calfeutrent. Mais justement, ce foyer, c’était comme la possibilité de les contenir, de les choyer, nos fantômes. Je me sens salaud, salaud de ma trop longue sérénité, salaud d’avoir oublié de ne compter que sur moi-même. Les larmes ne viennent même pas. Tout est froid, comme le verre givré qu’imprime la vitre sur mon dos nu. La colère est blanche et résignée.
Sans but, je remonte à l’étage, à pas de loup. Dans l’entrebâillement, je vois son corps immobile, courbé dans les draps. Je la regarde et les choses s’apaisent un peu. Victoria est la seule qui me fasse du bien. Je suis fou de son esprit, de sa luminosité.
Je suis mordu de ses poignets, de sa nuque, de ses grosses fesses et de sa peau. Hier soir, nous faisions l’amour, la même fièvre chaque fois, mes yeux plongés dans les siens d’un vert qui renverse le monde. J’imagine le jour où l’enfant sera là, dans la pièce à gauche, moi père à vingt et un ans. C’est irrationnel, des gamins qui ont des gamins. Cet enfant, notre amour avec Victoria, j’ai cru qu’ils m’offriraient l’opportunité d’échapper au morbide familial. J’observe Victoria. Elle a failli me sauver, mais failli seulement. Je me fais la réflexion que je tuerais pour elle, facilement. L’idée qu’on puisse lui faire du mal m’est insupportable. Mais c’est maintenant à mon propre mal qu’il est pénible de songer. Parce que cette rage, couvée silencieusement, n’est pas un trait de caractère auquel j’ai habitué mes proches. Où est le Pierre que les gens connaissent, gentil, subtil et attachant ?
Je respire moins bien, au bord de l’angoisse. Je redescends au rez-de-chaussée et me fous sur le canapé, la tasse brûlante à la main. Je pense à ma mère. Sophie et son absence éternelle. À mes grands-parents, avec qui j’ai grandi, eux qui m’ont élevé sans père ni mère. Suzanne, Théodore. J’irai au cimetière avant de prendre la route.
Je sors mon téléphone, parcours machinalement l’actualité. Rien ne va, et tout le monde s’exprime. Nous gagnerions pourtant du temps à nous épargner nos hypocrisies, à la fermer par moments. Disparition de la nuance, règne des ego et des discours bilieux. Je constate que nous sommes nombreux à chier sur la société, cette structure humaine qui a abandonné l’idée de tendre vers l’équilibre plutôt que la surabondance. Ce monde qui laisse couler des hommes au fond des mers, brûle et ne s’inquiète que des tendances à la une. Rien ne m’incite à participer à cette grande mascarade. Ceux qui tiennent le système, plongés dans leur mépris, se soucient si peu des gens, si peu de prendre soin. Dans ce monde-là, Sophie était perdue d’avance.
Je tente pour ma part de construire une histoire qui se tient, de continuer à donner le change, et dans six mois me voici père. J’apprends vite, mal, je cherche pour cet enfant à laisser quelque chose d’articulé. À faire mentir nos histoires, à ne rien reproduire. Et tout ça pour quoi, en définitive ? Balayer l’espoir d’un revers de haine ? Oui, la haine. Toute mon adolescence, j’ai vacillé, incapable d’avoir un tant soit peu d’orgueil. Toujours le profil bas. Mon grand-père m’a appris le doute. Mon cul, le doute. C’est terminé. J’ai perdu mes illusions quant à la marche de l’avenir. J’en suis la preuve tangible : l’humanité est une salope. Avec sa part de beauté et de poésie, comme le fusain libre d’un nu sur le Canson. Mais surtout son lot de mauvais sentiments, d’aigreur, de bêtise, d’inaptitude à se soustraire à la violence. Voilà où nous en sommes. Reste une question qui ne me quitte plus désormais, depuis que Victoria m’a annoncé la nouvelle : est-ce que ça a encore du sens d’aller au bout des choses ?
J’entends l’escalier craquer sous des pas molletonnés. Victoria entre, vient déposer un baiser du matin, les lèvres sèches, sur ma joue. Elle place une dosette dans la machine, enclenche le bouton de marche. Le ronron se fait entendre et Victoria se retourne. Elle s’est arrondie. Depuis un mois, elle a les cheveux courts. Brune en hiver, je l’avais connue presque rouquine en juillet. Je l’ai toujours trouvée irrésistible au réveil, Victoria. Le pli de l’oreiller imprimé au coin de ses yeux, les paupières encore mi-closes, son nez retroussé, la malice de son visage… tout me plaît chez elle. Elle me pose une question, je n’entends pas. Je retrouve l’idée sombre, évaporée l’espace de quelques minutes.
Seule la pensée d’un défoulement de colère me soulage. Je regarde mon amoureuse sans vraiment la regarder. Il faut partir.
Je suis le couloir, nauséeux, pour monter à la chambre. J’enfile une polaire, je passe mon blouson noir. Je tire d’un tiroir de la commode des gants de cuir et de sous le fauteuil attenant une paire de chaussures. Dans le bureau, je prends le vieux flingue familial, rouillé et inutilisé depuis des années. Je me persuade que ce n’est pas un problème, un pistolet obsolète. Après tout, il ne me suffit que d’une cartouche.
En bas, Victoria est adossée contre l’îlot de la cuisine. Elle commence à me connaître, bien sûr, mais cette fois-ci elle ne sait pas. Elle est au courant pour l’appel
Je suis mordu de ses poignets, de sa nuque, de ses grosses fesses et de sa peau. Hier soir, nous faisions l’amour, la même fièvre chaque fois, mes yeux plongés dans les siens d’un vert qui renverse le monde. J’imagine le jour où l’enfant sera là, dans la pièce à gauche, moi père à vingt et un ans. C’est irrationnel, des gamins qui ont des gamins. Cet enfant, notre amour avec Victoria, j’ai cru qu’ils m’offriraient l’opportunité d’échapper au morbide familial. J’observe Victoria. Elle a failli me sauver, mais failli seulement. Je me fais la réflexion que je tuerais pour elle, facilement. L’idée qu’on puisse lui faire du mal m’est insupportable. Mais c’est maintenant à mon propre mal qu’il est pénible de songer. Parce que cette rage, couvée silencieusement, n’est pas un trait de caractère auquel j’ai habitué mes proches. Où est le Pierre que les gens connaissent, gentil, subtil et attachant ?
Je respire moins bien, au bord de l’angoisse. Je redescends au rez-de-chaussée et me fous sur le canapé, la tasse brûlante à la main. Je pense à ma mère. Sophie et son absence éternelle. À mes grands-parents, avec qui j’ai grandi, eux qui m’ont élevé sans père ni mère. Suzanne, Théodore. J’irai au cimetière avant de prendre la route.
Je sors mon téléphone, parcours machinalement l’actualité. Rien ne va, et tout le monde s’exprime. Nous gagnerions pourtant du temps à nous épargner nos hypocrisies, à la fermer par moments. Disparition de la nuance, règne des ego et des discours bilieux. Je constate que nous sommes nombreux à chier sur la société, cette structure humaine qui a abandonné l’idée de tendre vers l’équilibre plutôt que la surabondance. Ce monde qui laisse couler des hommes au fond des mers, brûle et ne s’inquiète que des tendances à la une. Rien ne m’incite à participer à cette grande mascarade. Ceux qui tiennent le système, plongés dans leur mépris, se soucient si peu des gens, si peu de prendre soin. Dans ce monde-là, Sophie était perdue d’avance.
Je tente pour ma part de construire une histoire qui se tient, de continuer à donner le change, et dans six mois me voici père. J’apprends vite, mal, je cherche pour cet enfant à laisser quelque chose d’articulé. À faire mentir nos histoires, à ne rien reproduire. Et tout ça pour quoi, en définitive ? Balayer l’espoir d’un revers de haine ? Oui, la haine. Toute mon adolescence, j’ai vacillé, incapable d’avoir un tant soit peu d’orgueil. Toujours le profil bas. Mon grand-père m’a appris le doute. Mon cul, le doute. C’est terminé. J’ai perdu mes illusions quant à la marche de l’avenir. J’en suis la preuve tangible : l’humanité est une salope. Avec sa part de beauté et de poésie, comme le fusain libre d’un nu sur le Canson. Mais surtout son lot de mauvais sentiments, d’aigreur, de bêtise, d’inaptitude à se soustraire à la violence. Voilà où nous en sommes. Reste une question qui ne me quitte plus désormais, depuis que Victoria m’a annoncé la nouvelle : est-ce que ça a encore du sens d’aller au bout des choses ?
J’entends l’escalier craquer sous des pas molletonnés. Victoria entre, vient déposer un baiser du matin, les lèvres sèches, sur ma joue. Elle place une dosette dans la machine, enclenche le bouton de marche. Le ronron se fait entendre et Victoria se retourne. Elle s’est arrondie. Depuis un mois, elle a les cheveux courts. Brune en hiver, je l’avais connue presque rouquine en juillet. Je l’ai toujours trouvée irrésistible au réveil, Victoria. Le pli de l’oreiller imprimé au coin de ses yeux, les paupières encore mi-closes, son nez retroussé, la malice de son visage… tout me plaît chez elle. Elle me pose une question, je n’entends pas. Je retrouve l’idée sombre, évaporée l’espace de quelques minutes.
Seule la pensée d’un défoulement de colère me soulage. Je regarde mon amoureuse sans vraiment la regarder. Il faut partir.
Je suis le couloir, nauséeux, pour monter à la chambre. J’enfile une polaire, je passe mon blouson noir. Je tire d’un tiroir de la commode des gants de cuir et de sous le fauteuil attenant une paire de chaussures. Dans le bureau, je prends le vieux flingue familial, rouillé et inutilisé depuis des années. Je me persuade que ce n’est pas un problème, un pistolet obsolète. Après tout, il ne me suffit que d’une cartouche.
En bas, Victoria est adossée contre l’îlot de la cuisine. Elle commence à me connaître, bien sûr, mais cette fois-ci elle ne sait pas. Elle est au courant pour l’appel
Je suis mordu de ses poignets, de sa nuque, de ses grosses fesses et de sa peau. Hier soir, nous faisions l’amour, la même fièvre chaque fois, mes yeux plongés dans les siens d’un vert qui renverse le monde. J’imagine le jour où l’enfant sera là, dans la pièce à gauche, moi père à vingt et un ans. C’est irrationnel, des gamins qui ont des gamins. Cet enfant, notre amour avec Victoria, j’ai cru qu’ils m’offriraient l’opportunité d’échapper au morbide familial. J’observe Victoria. Elle a failli me sauver, mais failli seulement. Je me fais la réflexion que je tuerais pour elle, facilement. L’idée qu’on puisse lui faire du mal m’est insupportable. Mais c’est maintenant à mon propre mal qu’il est pénible de songer. Parce que cette rage, couvée silencieusement, n’est pas un trait de caractère auquel j’ai habitué mes proches. Où est le Pierre que les gens connaissent, gentil, subtil et attachant ?
Je respire moins bien, au bord de l’angoisse. Je redescends au rez-de-chaussée et me fous sur le canapé, la tasse brûlante à la main. Je pense à ma mère. Sophie et son absence éternelle. À mes grands-parents, avec qui j’ai grandi, eux qui m’ont élevé sans père ni mère. Suzanne, Théodore. J’irai au cimetière avant de prendre la route.
Je sors mon téléphone, parcours machinalement l’actualité. Rien ne va, et tout le monde s’exprime. Nous gagnerions pourtant du temps à nous épargner nos hypocrisies, à la fermer par moments. Disparition de la nuance, règne des ego et des discours bilieux. Je constate que nous sommes nombreux à chier sur la société, cette structure humaine qui a abandonné l’idée de tendre vers l’équilibre plutôt que la surabondance. Ce monde qui laisse couler des hommes au fond des mers, brûle et ne s’inquiète que des tendances à la une. Rien ne m’incite à participer à cette grande mascarade. Ceux qui tiennent le système, plongés dans leur mépris, se soucient si peu des gens, si peu de prendre soin. Dans ce monde-là, Sophie était perdue d’avance.
Je tente pour ma part de construire une histoire qui se tient, de continuer à donner le change, et dans six mois me voici père. J’apprends vite, mal, je cherche pour cet enfant à laisser quelque chose d’articulé. À faire mentir nos histoires, à ne rien reproduire. Et tout ça pour quoi, en définitive ? Balayer l’espoir d’un revers de haine ? Oui, la haine. Toute mon adolescence, j’ai vacillé, incapable d’avoir un tant soit peu d’orgueil. Toujours le profil bas. Mon grand-père m’a appris le doute. Mon cul, le doute. C’est terminé. J’ai perdu mes illusions quant à la marche de l’avenir. J’en suis la preuve tangible : l’humanité est une salope. Avec sa part de beauté et de poésie, comme le fusain libre d’un nu sur le Canson. Mais surtout son lot de mauvais sentiments, d’aigreur, de bêtise, d’inaptitude à se soustraire à la violence. Voilà où nous en sommes. Reste une question qui ne me quitte plus désormais, depuis que Victoria m’a annoncé la nouvelle : est-ce que ça a encore du sens d’aller au bout des choses ?
J’entends l’escalier craquer sous des pas molletonnés. Victoria entre, vient déposer un baiser du matin, les lèvres sèches, sur ma joue. Elle place une dosette dans la machine, enclenche le bouton de marche. Le ronron se fait entendre et Victoria se retourne. Elle s’est arrondie. Depuis un mois, elle a les cheveux courts. Brune en hiver, je l’avais connue presque rouquine en juillet. Je l’ai toujours trouvée irrésistible au réveil, Victoria. Le pli de l’oreiller imprimé au coin de ses yeux, les paupières encore mi-closes, son nez retroussé, la malice de son visage… tout me plaît chez elle. Elle me pose une question, je n’entends pas. Je retrouve l’idée sombre, évaporée l’espace de quelques minutes.
Seule la pensée d’un défoulement de colère me soulage. Je regarde mon amoureuse sans vraiment la regarder. Il faut partir.
Je suis le couloir, nauséeux, pour monter à la chambre. J’enfile une polaire, je passe mon blouson noir. Je tire d’un tiroir de la commode des gants de cuir et de sous le fauteuil attenant une paire de chaussures. Dans le bureau, je prends le vieux flingue familial, rouillé et inutilisé depuis des années. Je me persuade que ce n’est pas un problème, un pistolet obsolète. Après tout, il ne me suffit que d’une cartouche.
En bas, Victoria est adossée contre l’îlot de la cuisine. Elle commence à me connaître, bien sûr, mais cette fois-ci elle ne sait pas. Elle est au courant pour l’appel
Je suis mordu de ses poignets, de sa nuque, de ses grosses fesses et de sa peau. Hier soir, nous faisions l’amour, la même fièvre chaque fois, mes yeux plongés dans les siens d’un vert qui renverse le monde. J’imagine le jour où l’enfant sera là, dans la pièce à gauche, moi père à vingt et un ans. C’est irrationnel, des gamins qui ont des gamins. Cet enfant, notre amour avec Victoria, j’ai cru qu’ils m’offriraient l’opportunité d’échapper au morbide familial. J’observe Victoria. Elle a failli me sauver, mais failli seulement. Je me fais la réflexion que je tuerais pour elle, facilement. L’idée qu’on puisse lui faire du mal m’est insupportable. Mais c’est maintenant à mon propre mal qu’il est pénible de songer. Parce que cette rage, couvée silencieusement, n’est pas un trait de caractère auquel j’ai habitué mes proches. Où est le Pierre que les gens connaissent, gentil, subtil et attachant ?
Je respire moins bien, au bord de l’angoisse. Je redescends au rez-de-chaussée et me fous sur le canapé, la tasse brûlante à la main. Je pense à ma mère. Sophie et son absence éternelle. À mes grands-parents, avec qui j’ai grandi, eux qui m’ont élevé sans père ni mère. Suzanne, Théodore. J’irai au cimetière avant de prendre la route.
Je sors mon téléphone, parcours machinalement l’actualité. Rien ne va, et tout le monde s’exprime. Nous gagnerions pourtant du temps à nous épargner nos hypocrisies, à la fermer par moments. Disparition de la nuance, règne des ego et des discours bilieux. Je constate que nous sommes nombreux à chier sur la société, cette structure humaine qui a abandonné l’idée de tendre vers l’équilibre plutôt que la surabondance. Ce monde qui laisse couler des hommes au fond des mers, brûle et ne s’inquiète que des tendances à la une. Rien ne m’incite à participer à cette grande mascarade. Ceux qui tiennent le système, plongés dans leur mépris, se soucient si peu des gens, si peu de prendre soin. Dans ce monde-là, Sophie était perdue d’avance.
Je tente pour ma part de construire une histoire qui se tient, de continuer à donner le change, et dans six mois me voici père. J’apprends vite, mal, je cherche pour cet enfant à laisser quelque chose d’articulé. À faire mentir nos histoires, à ne rien reproduire. Et tout ça pour quoi, en définitive ? Balayer l’espoir d’un revers de haine ? Oui, la haine. Toute mon adolescence, j’ai vacillé, incapable d’avoir un tant soit peu d’orgueil. Toujours le profil bas. Mon grand-père m’a appris le doute. Mon cul, le doute. C’est terminé. J’ai perdu mes illusions quant à la marche de l’avenir. J’en suis la preuve tangible : l’humanité est une salope. Avec sa part de beauté et de poésie, comme le fusain libre d’un nu sur le Canson. Mais surtout son lot de mauvais sentiments, d’aigreur, de bêtise, d’inaptitude à se soustraire à la violence. Voilà où nous en sommes. Reste une question qui ne me quitte plus désormais, depuis que Victoria m’a annoncé la nouvelle : est-ce que ça a encore du sens d’aller au bout des choses ?
J’entends l’escalier craquer sous des pas molletonnés. Victoria entre, vient déposer un baiser du matin, les lèvres sèches, sur ma joue. Elle place une dosette dans la machine, enclenche le bouton de marche. Le ronron se fait entendre et Victoria se retourne. Elle s’est arrondie. Depuis un mois, elle a les cheveux courts. Brune en hiver, je l’avais connue presque rouquine en juillet. Je l’ai toujours trouvée irrésistible au réveil, Victoria. Le pli de l’oreiller imprimé au coin de ses yeux, les paupières encore mi-closes, son nez retroussé, la malice de son visage… tout me plaît chez elle. Elle me pose une question, je n’entends pas. Je retrouve l’idée sombre, évaporée l’espace de quelques minutes.
Seule la pensée d’un défoulement de colère me soulage. Je regarde mon amoureuse sans vraiment la regarder. Il faut partir.
Je suis le couloir, nauséeux, pour monter à la chambre. J’enfile une polaire, je passe mon blouson noir. Je tire d’un tiroir de la commode des gants de cuir et de sous le fauteuil attenant une paire de chaussures. Dans le bureau, je prends le vieux flingue familial, rouillé et inutilisé depuis des années. Je me persuade que ce n’est pas un problème, un pistolet obsolète. Après tout, il ne me suffit que d’une cartouche.
En bas, Victoria est adossée contre l’îlot de la cuisine. Elle commence à me connaître, bien sûr, mais cette fois-ci elle ne sait pas. Elle est au courant pour l’appel
Je suis mordu de ses poignets, de sa nuque, de ses grosses fesses et de sa peau. Hier soir, nous faisions l’amour, la même fièvre chaque fois, mes yeux plongés dans les siens d’un vert qui renverse le monde. J’imagine le jour où l’enfant sera là, dans la pièce à gauche, moi père à vingt et un ans. C’est irrationnel, des gamins qui ont des gamins. Cet enfant, notre amour avec Victoria, j’ai cru qu’ils m’offriraient l’opportunité d’échapper au morbide familial. J’observe Victoria. Elle a failli me sauver, mais failli seulement. Je me fais la réflexion que je tuerais pour elle, facilement. L’idée qu’on puisse lui faire du mal m’est insupportable. Mais c’est maintenant à mon propre mal qu’il est pénible de songer. Parce que cette rage, couvée silencieusement, n’est pas un trait de caractère auquel j’ai habitué mes proches. Où est le Pierre que les gens connaissent, gentil, subtil et attachant ?
Je respire moins bien, au bord de l’angoisse. Je redescends au rez-de-chaussée et me fous sur le canapé, la tasse brûlante à la main. Je pense à ma mère. Sophie et son absence éternelle. À mes grands-parents, avec qui j’ai grandi, eux qui m’ont élevé sans père ni mère. Suzanne, Théodore. J’irai au cimetière avant de prendre la route.
Je sors mon téléphone, parcours machinalement l’actualité. Rien ne va, et tout le monde s’exprime. Nous gagnerions pourtant du temps à nous épargner nos hypocrisies, à la fermer par moments. Disparition de la nuance, règne des ego et des discours bilieux. Je constate que nous sommes nombreux à chier sur la société, cette structure humaine qui a abandonné l’idée de tendre vers l’équilibre plutôt que la surabondance. Ce monde qui laisse couler des hommes au fond des mers, brûle et ne s’inquiète que des tendances à la une. Rien ne m’incite à participer à cette grande mascarade. Ceux qui tiennent le système, plongés dans leur mépris, se soucient si peu des gens, si peu de prendre soin. Dans ce monde-là, Sophie était perdue d’avance.
Je tente pour ma part de construire une histoire qui se tient, de continuer à donner le change, et dans six mois me voici père. J’apprends vite, mal, je cherche pour cet enfant à laisser quelque chose d’articulé. À faire mentir nos histoires, à ne rien reproduire. Et tout ça pour quoi, en définitive ? Balayer l’espoir d’un revers de haine ? Oui, la haine. Toute mon adolescence, j’ai vacillé, incapable d’avoir un tant soit peu d’orgueil. Toujours le profil bas. Mon grand-père m’a appris le doute. Mon cul, le doute. C’est terminé. J’ai perdu mes illusions quant à la marche de l’avenir. J’en suis la preuve tangible : l’humanité est une salope. Avec sa part de beauté et de poésie, comme le fusain libre d’un nu sur le Canson. Mais surtout son lot de mauvais sentiments, d’aigreur, de bêtise, d’inaptitude à se soustraire à la violence. Voilà où nous en sommes. Reste une question qui ne me quitte plus désormais, depuis que Victoria m’a annoncé la nouvelle : est-ce que ça a encore du sens d’aller au bout des choses ?
J’entends l’escalier craquer sous des pas molletonnés. Victoria entre, vient déposer un baiser du matin, les lèvres sèches, sur ma joue. Elle place une dosette dans la machine, enclenche le bouton de marche. Le ronron se fait entendre et Victoria se retourne. Elle s’est arrondie. Depuis un mois, elle a les cheveux courts. Brune en hiver, je l’avais connue presque rouquine en juillet. Je l’ai toujours trouvée irrésistible au réveil, Victoria. Le pli de l’oreiller imprimé au coin de ses yeux, les paupières encore mi-closes, son nez retroussé, la malice de son visage… tout me plaît chez elle. Elle me pose une question, je n’entends pas. Je retrouve l’idée sombre, évaporée l’espace de quelques minutes.
Seule la pensée d’un défoulement de colère me soulage. Je regarde mon amoureuse sans vraiment la regarder. Il faut partir.
Je suis le couloir, nauséeux, pour monter à la chambre. J’enfile une polaire, je passe mon blouson noir. Je tire d’un tiroir de la commode des gants de cuir et de sous le fauteuil attenant une paire de chaussures. Dans le bureau, je prends le vieux flingue familial, rouillé et inutilisé depuis des années. Je me persuade que ce n’est pas un problème, un pistolet obsolète. Après tout, il ne me suffit que d’une cartouche. »