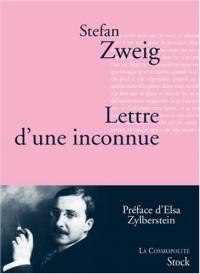
" De retour à Vienne, tôt dans la matinée, après trois jours revigorants passés à la montagne, le célèbre romancier R. n'eut qu'à survoler la date du journal qu'il venait d'acheter à la gare pour se rappeler que c'était aujourd'hui son anniversaire. Son quarante-et-unième anniversaire, eut-il vite fait de calculer, et cela ne lui fit ni chaud ni froid. Il feuilleta distraitement le journal, dont les pages crépitaient sous ses doigts, et prit un taxi pour regagner son appartement. En son absence, R. avait reçu deux visites et quelques appels téléphoniques. Son domestique le mit au fait et lui apporta sur un plateau le courrier des trois derniers jours. R. examina tranquillement le paquet, déchira quelques enveloppes, celles dont les expéditeurs l'intéressaient ; il mit d'emblée de côté une lettre portant une écriture qu'il ne connaissait pas, et qui lui paraissait bien volumineuse. Le thé était servi ; il se cala confortablement dans son fauteuil, feuilleta une dernière fois le journal et quelques prospectus ; puis il alluma un cigare et attrapa la lettre qu'il avait réservée.
Deux douzaines de pages environ, rédigées à la hâte, couvertes d'une écriture de femme, inconnue et précipitée ; c'était plutôt un manuscrit qu'une lettre. Il reprit l'enveloppe et la palpa d'un geste machinal comme pour s'assurer qu'aucun mot d'accompagnement n'était resté au fond. Mais l'enveloppe était vide et pas plus que les feuillets eux-mêmes elle ne portait d'adresse d'expéditeur ou de signature. « Étrange », se dit-il, et il reprit le manuscrit. Il y avait écrit au haut de la page, en guise d'apostrophe, d'épigraphe : « À toi qui jamais ne m'aura connue. » Très étonné, il interrompit sa lecture : s'adressait-on à lui, s'adressait-on à un personnage imaginaire ? Sa curiosité était soudain piquée. Il se mit à lire :
Mon enfant est mort hier. Trois jours et trois nuits durant, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette tendre petite vie ; quarante heures durant, alors que la grippe secouait de fièvre son pauvre corps, je suis restée à le veiller. J'ai appliqué des linges frais sur son front ardent ; nuit et jour j'ai tenu ses petites mains fébriles dans les miennes. Au troisième soir, je me suis effondrée. Mes yeux n'en pouvaient plus, ils se fermaient sans que je m'en rende compte. J'ai dormi trois, peut-être quatre heures sur un mauvais fauteuil, et la mort en a profité pour s'emparer de lui. Maintenant il repose là-bas, le pauvre chéri, sur son petit lit d'enfant, dans la position où la mort l'a pris ; on lui a simplement fermé les yeux, ses yeux sombres et intelligents ; on a joint ses mains sur sa chemise blanche, et quatre cierges brûlent d'une flamme vive aux quatre coins du lit. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car quand les flammes vacillent, des ombres passent sur son visage et sur sa bouche close ; alors c'est comme si ses traits s'animaient, et je croirais presque qu'il n'est pas mort, qu'il se réveillera et que de sa voix claire il me dira des mots pleins de tendresse enfantine. Mais je le sais, il est mort, et je ne veux plus regarder, pour n'avoir plus à espérer, pour n'être pas déçue une fois de plus. Je sais, je le sais bien qu'il est mort, mon enfant est mort hier. Maintenant je n'ai plus que toi au monde, toi qui ne sais rien de moi, toi qui en ce moment même joues sans te douter de rien, ou alors t'amuses de quelque objet ou personne. Plus que toi qui jamais ne m'auras connue et que j'aurai toujours aimé.J'ai pris le cinquième cierge et l'ai posé là, sur la table où je t'écris. Car je ne peux pas rester seule avec mon enfant mort sans épancher mon âme, et à qui pouvais-je parler en cette heure terrible sinon à toi, toi qui m'étais tout et m'es tout ! Peut-être que je ne parviendrai pas à te parler avec toute la clarté souhaitable, peut-être que tu ne me comprendras pas – j'ai la tête si lourde c'est vrai, le sang bat et bourdonne dans mes tempes, mes membres me font si mal. Je crois que j'ai la fièvre, peut-être est-ce déjà la grippe, qui va maintenant de porte en porte ; ce serait bien, car alors je partirais avec mon enfant et je n'aurais pas à me faire violence. Par moments mes yeux se couvrent de noir, peut-être n'arriverai-je même pas à finir d'écrire cette lettre – mais je veux rassembler toutes mes forces, pour qu'une fois, rien que cette fois, je puisse te parler, à toi mon aimé, toi qui jamais ne m'auras reconnue.
C'est à toi seul que je veux parler, c'est à toi que je dirai tout pour la première fois ; tu sauras tout de ma vie qui n'appartenait qu'à toi et dont tu n'as jamais rien su. Mais tu ne connaîtras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu ne me devras plus de réponse ; et encore faut-il que ce mal, qui à cette heure souffle le chaud et le froid dans mes membres, annonce vraiment la fin. Si je devais survivre, je déchirerais cette lettre et continuerais à me taire comme je l'ai toujours fait. En revanche, si cette lettre te parvient, tu sauras que c'est une morte qui te raconte sa vie, sa vie qui t'aura appartenu dès l'éveil de sa conscience et jusqu'à sa dernière heure. Tu n'as rien à craindre de mes paroles ; une morte ne désire plus rien, elle ne veut ni amour, ni pitié, ni consolation. Je ne te demande qu'une chose : je veux que tu croies tout ce que ma douleur, qui s'évade vers toi, va te révéler. Crois-moi sur parole, c'est tout ce que je te demande : on ne saurait mentir juste après la mort de son seul enfant.
Je veux te dévoiler toute ma vie, cette vie qui n'a vraiment commencé que le jour où je t'ai connu. Avant cela, il y avait au plus quelque chose de trouble et de confus, vers quoi ma mémoire n'a plus jamais plongé, une sorte de cave pleine d'objets et de gens poussiéreux, couverts de toiles d'araignées, et dont mon cœur ne sait plus rien. Quand tu es arrivé, j'avais treize ans et j'habitais dans cet immeuble que tu habites encore aujourd'hui, dans cet immeuble où tu tiens ma lettre, mon dernier souffle de vie, entre tes mains ; j'habitais sur le même palier, juste en face de la porte de ton appartement. Tu ne te souviens certainement plus de nous, de la pauvre veuve de fonctionnaire des finances (elle était toujours en deuil) et de la maigre adolescente. C'est que nous vivions si tranquilles, presque confinées dans notre misère petite-bourgeoise. Tu n'as peut-être jamais entendu notre nom, car nous n'avions pas de plaque à notre porte et personne ne venait, personne ne nous demandait. Et c'était il y a si longtemps, quinze, seize ans ; non, tu n'en sais certainement plus rien, non, aimé, mais moi, oh ! je me souviens passionnément de chaque détail, je me rappelle encore, comme si c'était hier, le jour, non, l'heure où j'ai entendu parler de toi pour la première fois, où je t'ai vu pour la première fois ; et comment aurais-je pu oublier, car c'est à ce moment-là que pour moi la vie commença. Consens, aimé, que je te raconte tout, tout depuis le début ; entends, je t'en prie, parler de moi ce seul quart d'heure sans te lasser, de moi qui de toute une vie n'ai pas cessé de t'aimer.
Avant que tu n'emménages dans notre immeuble, des gens horribles, méchants et querelleurs vivaient derrière ta porte. Pauvres comme ils étaient, ils détestaient par-dessus tout la pauvreté qui leur faisait face, la nôtre, car elle ne voulait rien avoir de commun avec leur grossièreté invétérée de prolétaires. Le mari était un ivrogne et il battait sa femme ; souvent nous étions réveillées la nuit par un remue-ménage de chaises renversées et d'assiettes brisées ; une nuit, battue jusqu'au sang, échevelée, elle a couru dans l'escalier, suivie par son ivrogne de mari qui vociférait, jusqu'à ce que les gens sortent à leurs portes et menacent d'appeler la police. Ma mère avait dès le début évité tout contact avec eux et m'avait interdit de parler aux enfants, qui se vengeaient sur moi à la moindre occasion. Quand ils me croisaient dans la rue, ils me jetaient des mots orduriers, et un jour ils m'ont lancé des boules de neige si dures que j'en eus le front tout ensanglanté. Tout l'immeuble s'accordait pour détester ces gens, si bien que le jour où les choses se gâtèrent – je crois que le mari a été mis en prison pour vol –, et qu'ils durent déménager avec leur fourbi, nous avons tous été soulagés. Pendant quelques jours, on put voir à la porte de l'immeuble l'écriteau « À louer », puis il fut décroché, et le concierge répandit très vite la nouvelle qu'un écrivain, un homme seul et sans histoires, avait pris l'appartement. C'est là que j'ai entendu ton nom pour la première fois.
Au bout de quelques jours à peine, vinrent des décorateurs, des peintres, des laveurs, des tapissiers chargés de débarrasser l'appartement de la crasse laissée par les anciens locataires ; on tapa au marteau, on cogna, on nettoya et gratta, mais ma mère ne pouvait que s'en réjouir : elle disait qu'on en avait enfin fini avec les sales affaires d'à côté. Toi, je ne t'ai pas aperçu, même lors du déménagement : tous ces travaux étaient supervisés par ton domestique, ce petit majordome grisonnant à l'air grave, qui dirigeait tout de manière discrète et efficace. Il nous imposait beaucoup, d'abord parce qu'on n'avait jamais connu de majordome dans notre immeuble faubourien, ensuite parce qu'il était on ne peut plus poli envers chacun, sans pour autant se mettre sur le même pied que les autres domestiques, et bavarder amicalement avec eux. Dès le premier jour, il considéra ma mère comme une dame, respectueusement ; et même envers moi, qui n'étais qu'une gamine, il se montrait toujours confiant et sérieux. Quand il te nommait, c'était toujours avec une certaine déférence, avec un respect particulier – on voyait tout de suite qu'il était attaché à toi par des liens bien plus forts que le simple service domestique. Et comme je l'aimais pour cela, ce bon vieux Johann, même si je lui enviais le droit d'être toujours autour de toi à te servir.
Je te raconte tout cela, aimé, toutes ces petites choses presque ridicules, pour que tu comprennes comment tu as pu, dès le début, prendre un tel ascendant sur l'enfant timide et craintive que j'étais alors. Avant même que tu n'entres dans ma vie, il y avait déjà autour de ta personne une auréole, un monde de richesse, d'étrangeté et de mystère. Tous, dans le petit immeuble des faubourgs (les gens qui ont une vie limitée sont toujours curieux des nouveautés qui arrivent à leur porte), nous attendions ton arrivée avec impatience. Et cette curiosité que tu nous inspirais, comme elle grandit pour moi lorsqu'un après-midi, en rentrant de l'école, je vis garé devant notre immeuble le véhicule de déménagement ! Le gros des meubles, les pièces les plus lourdes, les déménageurs les avaient déjà montés ; il n'y avait plus qu'à monter un à un les objets les plus petits. Je suis restée debout à la porte pour pouvoir tout admirer, car toutes tes affaires avaient quelque chose de neuf et d'insolite à mes yeux ; il y avait là des figurines hindoues, des sculptures italiennes, de grands tableaux bariolés, et pour finir, des livres. Je ne pensais pas qu'on pouvait en avoir autant et d'aussi beaux. On les entassait tous à la porte, et là le domestique prenait le relais et commençait par les épousseter soigneusement un à un à l'aide d'un bâton et d'un plumeau. Je tournais autour de la pile grandissante de livres et y jetais un œil curieux ; le domestique ne me chassait pas, mais il ne m'encourageait pas non plus, de sorte que je n'osais en toucher un seul. Et Dieu sait combien j'aurais aimé caresser le cuir souple de certains d'entre eux. Je hasardai seulement un œil craintif sur les titres : il y en avait en français, en anglais, et quelques-uns dans des langues que je ne connaissais pas. Je crois que j'aurais pu passer des heures à tous les contempler si ma mère ne m'avait pas subitement rappelée chez nous.
De toute la soirée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi ; et je ne t'avais même pas encore vu. Je ne possédais quant à moi qu'une douzaine de livres bon marché, reliés en carton raboté par l'usage ; je les aimais par-dessus tout et les relisais sans cesse. Et voilà que je brûlais de savoir quel genre d'individu pouvait bien posséder et avoir lu tous ces livres magnifiques, connaître toutes ces langues, être à la fois si riche et si savant. La vue de tous ces livres m'inspirait une sorte de respect surnaturel. J'essayai de me forger une image de toi : tu devais être un homme âgé, avec des lunettes et une longue barbe blanche, un peu comme notre professeur de géographie, mais en plus aimable, beau et doux. J'ignore pourquoi j'ai toujours su que tu étais beau, même quand je te prenais encore pour un vieil homme. Cette nuit-là, sans te connaître encore, j'ai rêvé de toi pour la première fois."