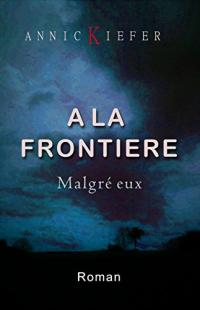
Préface
1940-1945 : période brune et rouge sang de l’Alsace, période de sa mémoire blessée. Période où l’Alsace annexée est non pas « simplement » occupée comme le reste de la France mais subit une entreprise systématique et brutale de nazification.
Une population surveillée, enrégimentée, mise au pas ; 130 000 jeunes Alsaciens incorporés de force dans la Wehrmacht, voire après 1944 directement dans la Waffen SS ; les neuf-dixième envoyés sur le front russe, là où la guerre contre les Partisans est la plus brutale et la plus inhumaine ; les filles enrégimentées dans le Reichsarbeitsdienst avant, pour beaucoup d’entre elles, d’être obligées de servir dans les villes bombardées du Reich.
1940-1945 : Tambov, le camp russe des prisonniers français, la mort par le froid, la famine et les mauvais traitements.
1940-1945 : Oradour-sur-Glane, le crime de guerre le plus épouvantable commis sur le sol français par une compagnie de la division des Waffen SS qui comptait 13 incorporés de force alsaciens. Le procès de ces hommes à Bordeaux en 1953, ouvre une longue période d’incompréhension et de rejet entre la nation et sa région de l’Est.
Environ 70 ans plus tard, cette période de l’histoire alsacienne fait l’objet de bien peu (bien trop peu) de travaux historiques et de beaucoup (trop) de commémorations. Le devoir de mémoire, parce qu’il occulte la complexité de l’événement, rend difficile, le plus souvent par maladresse, le travail d’apaisement de la mémoire collective, régionale et nationale, que seule l’histoire peut contribuer à favoriser.
Le devoir d’histoire est donc, à l’aube du XXIe siècle, une exigence citoyenne prioritaire afin de réconcilier mémoire régionale, mémoire nationale et mémoire européenne.
La recherche historique permettra en effet de démontrer à tous les Français que l’Alsace a connu un sort spécifique plus proche de celui de l’Allemagne que de celui de la France de l’intérieur, et que, parce qu’elle était considérée comme allemande par essence, comme appartenant au Volk, la politique menée par les autorités nazies visait non pas seulement à obtenir son obéissance mais sa pleine et entière adhésion.
Il faut marteler toujours et encore cette vérité : l’Alsace a été, pendant ces cinq années, soumise à une entreprise totalitaire.
Seul l’accomplissement de ce devoir d’histoire permettra de démontrer la complexité des situations en rejetant le blanc et le noir du jugement moral anachronique.
Il mettra aussi à jour la spécificité de la « sortie de guerre » en Alsace avec des familles déchirées quand l’un de ses enfants a refusé l’incorporation pour entrer, souvent, dans la Résistance, tandis que l’autre a été incorporé ; avec des familles envoyées au camp de « rééducation » de Schirmeck avant d’être transplantées (umgesiedelt) dans le Grand Reich ; avec des individus et des familles qui ont adhéré au projet nazi soit parce qu’ils avaient été déçus et blessés par la France soit par carriérisme, soit parce que la guerre, c’est bon pour les affaires (au noir).
La guerre a blessé l’Alsace, l’immédiat après-guerre aussi avec ses femmes tondues, avec ses profiteurs impunis, avec ses résistants de la toute dernière heure, avec ses « survivants-revenants » de Tambov.
Devoir donc de vérité (s) que ce devoir d’histoire…
Or, le discours de vérité peut être tenu par un roman, fictionnel par définition. Les historiens des totalitarismes savent, plus encore que ceux des autres périodes, que leur écriture est impuissante à rendre justice à toute la complexité des destins et à rendre compte des souffrances individuelles et collectives.
Alors, oui, le roman peut être un autre discours de vérité, il permet par ses personnages insérés dans la Grande histoire de donner à ressentir des vérités humaines qui échappent à tout discours scientifique.
C’est ce que réalise Annick Kiefer dans son nouveau roman. Elle brosse une fresque alsacienne où les destins entremêlés de ses personnages donnent à voir sur trois générations les blessures collectives qui ont empoisonné la région depuis 1870. Le roman contribue, par la finesse des portraits individuels, à faire connaître à la France une part de la vérité alsacienne. Les émotions que le lecteur ressentira à la lecture seront le vecteur d’une meilleure compréhension d’une région dont la différence ignorée ou niée est depuis trop longtemps source de tensions et de divisions du « corps » national.
Ce roman prend sa part, une belle part, dans l’accomplissement du devoir d’histoire.
Marie-Claire Vitoux
Maître de conférences honoraire en histoire contemporaine, Université de Haute Alsace,
Membre du Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les Techniques. (CRESAT)
En mémoire de…
François Peter, réfractaire au joug nazi, qui franchit la frontière Suisse le 12 juin 1941. Engagé volontaire dans la 1ère DB, il fit la campagne d'Allemagne avant d'être démobilisé en octobre 1945. Ses parents et sa sœur, furent, en représailles, emprisonnés au camp de rééducation de Schirmeck, avant d'être exilés à Ulm, en Allemagne. Malades, affaiblis, ils retrouvèrent leur fils, ce « héros » qui porta, toute sa vie durant, le poids de la culpabilité.
Pierre Jordan, enrôlé de force dans l'armée allemande, prisonnier des Russes à Tambov, où il est mort de maladie ou d'épuisement, alors que la guerre était finie.
Charles Soret, autre Malgré-Nous dans l'armée du Reich. Plus de soixante ans après son incorporation de force, il ne pouvait évoquer cette période sans s'effondrer et malgré son désir, renoncer à soulever le voile sur son passé.
A la mémoire de toutes ces existences, jadis emportées tels des fétus de paille, par les tempêtes guerrières ; en hommage à toutes celles qui le sont aujourd'hui, qui le seront demain, parce que l'Histoire se répète, une histoire sans fin et sans frontière !
Avertissement
A la frontière est une œuvre de fiction, inspirée de faits réels, dont le principal est l’évasion et l’arrestation, en février 1943, de ceux que l’on nomme ici « les 17 de Ballersdorf ».
Dans ces pages, la réalité se mêle à la fiction, mélangeant des noms de lieux existants à d’autres fictifs. Mais la trame de fond historique est conforme à la réalité, même si ce que chacun des protagonistes de l’histoire en fait ne regarde que lui.
I. A la frontière des siens
1
Au travers des vitres poussiéreuses de l’autocar, Élisabeth voit défiler les collines du Sundgau, cette région du sud de l’Alsace qu’elle ne connaît pas. Son Alsace à elle est plate, et déroule ses champs et ses forêts touffues jusqu’à la rive boueuse du Rhin capricieux. Une terre d’alluvions, riche et généreuse, avec, pour horizon, la Forêt-Noire, berceau du soleil levant. En vis-à-vis, comme dans un miroir, la ligne bleue des Vosges où, en bout de course, il disparaît.
Depuis Mulhouse, elle a pu observer les transformations du paysage : de minuscules et nombreuses collines repoussent l’horizon, découpées de vergers étroits bordés de haies vives, couvertes de prairies pareilles à des rubans plissés. Partout, des reliefs et des bosses, aux creux desquels les villages s’étaient resserrés tout contre le chœur des églises.
En dépit des années écoulées depuis la guerre, il en subsiste encore maintes traces : quelques échafaudages ceignent des murs fissurés ; des briques et des solives calcinées s’entassent çà et là sur des friches ; des ouvriers, blancs de ciment, le torse huileux couvert d’une simple finette, donnent aux chantiers l’allure de fourmilières. Par endroits, les travaux de reconstruction sont achevés, plaquant sur les façades auparavant ornées de colombages des aplats gris et terne d’un ciment encore humide.
Même son père, désormais, fait partie de ces bâtisseurs. Mais reconstruira-t-il, un jour, leur petite maison du canal ? Elle n’avait pas pensé à lui poser la question.
Malgré une suffocante chaleur dans le car qui se traîne sur les routes sinueuses, Élisabeth réprime un frisson. Penser à son père vrille en elle l’essentiel de sa honte. Elle se tamponne le front de son mouchoir, s’apprête à retirer ses lunettes de soleil quand elle croise le regard du chauffeur dans le rétroviseur. L’homme a relevé sa casquette sur son front moite et lui sourit. Assise derrière lui, une vieille paysanne lui fait la conversation. Élisabeth constate alors que les quelques passagers montés à la gare d’Altkirch sont presque tous descendus aux arrêts précédents. Perdue dans ses pensées, elle ne l’avait pas remarqué, pas plus que le regard insistant du conducteur qui l’oblige à se détourner. Elle se lève et fait glisser la fenêtre pour apporter un peu d’air dans cette étuve. La moiteur de ce mois de juillet 1950 lui rappelle les étés torrides qu’elle a connus dans le Sud-Ouest.
Encore un souvenir brûlant comme de l’acide, qu’elle s’empresse de reléguer au fond de sa mémoire. Mais les instants récents n’ont rien à lui envier. La jeune femme ne peut pourtant les éloigner. À chaque fois qu’elle y revient, ils ont raison d’elle.
Ainsi, le matin même, dans le hall de la petite gare d’Altkirch, tandis qu’elle attendait l’autocar pour Roppensdorf qui ne partait pas avant le début d’après-midi, elle avait brusquement été submergée par l’émotion. Trop de tensions accumulées depuis son retour dans la maison familiale, trop de reproches, une lutte incessante entre les mots à dire et les maux à taire, et cet aveu dont elle savait qu’il avait détruit le seul lien qui l’arrimait encore à la vie : l’affection de son père. Son père qui l’admirait.
Le mois précédent, Élisabeth avait franchi le seuil de la maison familiale avec le ventre noué de ceux qui agissent à contrecœur. Dans la cour creusée d’ornières dures comme de la pierre, face à la maisonnette familiale, sa minuscule valise en carton à la main, elle avait dû refréner l’envie de faire demi-tour.
Mais elle était restée à fixer la maison de poupée, maintenue debout par une sorte de maillage en bois, et dont le faîtage ondulait, identique au profil des Vosges. Ses yeux se portèrent ensuite sur la grande maison de maître sise en vis-à-vis de celle, misérable, où elle avait passé une partie de sa jeunesse.
À l’époque où sa famille avait quitté la maison du canal pour investir l’annexe du Dr Katz, la petite avait cru qu’elle allait dorénavant vivre telle une princesse, dans ce qui, à ses yeux d’enfant pauvre, avait des allures de château. Elle ne se remit jamais de sa déception de devoir loger dans « l’annexe », comme chacun appelait encore la masure sombre et basse où résident encore ses parents.
Cela faisait presque dix ans qu’elle avait quitté l’annexe et rien ici ne semblait avoir changé.
Élisabeth revenait au bercail avec l’espoir que les épreuves avaient érodé le socle granitique des certitudes maternelles, effrité ses convictions, aboli ses rancunes. Elle espérait trouver le fil de la conversation pour raccommoder les déchirures du tissu familial.
Mais il lui suffit de se retrouver face au visage hostile de sa mère pour sentir ses illusions glisser au sol le long de son derme comme un habit trop large.
Le seul changement était apparent, marqué par un réseau de rides d’expression mauvaise. Sa mère avait pris trente ans à la douzaine, la contrariété de découvrir sa fille sur le seuil creusant davantage ses traits. Elle l’accueillit comme si elle était partie la veille, des reproches pleins ses petits yeux plissés, et les gestes brusquement nerveux comme ceux d’un huissier. De tout temps, sa mère avait été un paquet de nerfs qui se défaisait à peine secoué.
En Élisabeth bouillonnait le poison de ses rancunes, préparé à l’instant par le seul fait d’être en sa présence, et déjà prêt à être consommé. Elle retrouvait, intactes malgré le travail du temps et de l’oubli, toutes ses anciennes guerres qui se battaient sous sa peau, lui tiraient des larmes, explosaient à ses tempes. Si sa mémoire avait engrangé d’autres souvenirs, avait endormi ses réticences au point d’avoir autorisé son retour, ses émotions, quant à elles, étaient celles de l’enfant d’alors, dont la fuite restait la seule issue.
Elle avait oublié qu’elle n’avait pas oublié. Elle s’était aveuglée parce qu’elle ne savait plus guère quoi faire de son existence. Elle avait changé. La vie l’avait écornée comme un meuble ancien, avait rogné ses angles sans pour autant la rendre d’équerre. Et c’était l’âme bancale qu’elle était revenue, avec l’espoir insensé qu’une maman l’attendrait là. Mais c’était sa mère et personne d’autre qui, sur le seuil de sa porte, lui rappelait sans mot dire que l’espoir, c’est pour ceux qui ne connaissent rien de la vie.
En son for intérieur, Élisabeth ne s’était pas attendue à autre chose de sa part, mais elle fut en revanche profondément affectée par la réaction de son père lorsqu’il rentra du travail.
À l’instar de sa femme, il n’avait manifesté ni surprise, ni joie expansive à la vue de sa fille. Elle avait beau connaître son extrême pudeur, elle avait espéré, en ce jour de retour de l’enfant prodigue, des marques d’affection qui auraient soigné ses peines.
Élisabeth n’avait jamais vraiment regardé, avant d’y revenir, les rues et les maisons du village où elle avait grandi. Elle avait très tôt refusé de voir l’endroit de sa naissance avec indulgence. Elle avait considéré, avec l’assurance d’une enfant capricieuse et butée, qu’il y avait eu une erreur quelque part. Dieu, s’il existait, s’était forcément trompé en la mettant au monde dans cette famille besogneuse, éloignée des choses de l’esprit par la rigueur d’une âpre existence.
L’école fut son exutoire. Il lui fallait lire, apprendre tout le temps, pour faire abstraction de la boue de la cour qui collait aux semelles des chaussures du dimanche, ne plus renifler les déjections des poules, la puanteur du tas de fumier quand celles-ci l’agitaient de leurs pattes grêles pour y chercher leur pitance.
Apprendre pour ne pas voir ses parents s’esquinter la santé de l’aube à la tombée du jour, pliés en quatre sous le poids des sacs de patates, des brassées de paille, des baquets d’eau et de draps mouillés. Pour ne pas s’inquiéter des mains calleuses du père, striées de plaies et dont les articulations étaient si douloureuses qu’il ne parvenait plus, pour la soupe du soir, à y tremper son pain. Pour ne pas remarquer les doigts rouges et gonflés de la mère, qui passaient de l’eau bouillante de la lessiveuse aux gifles glaciales de la bise passant entre les cordes à linge.
C’est son père qui avait insisté pour qu’elle étudiât, là où la mère avait vu du temps perdu et une prétention absurde : selon elle, on ne peut échapper à sa condition, on ne modifie pas le destin, ni grâce à l’école, ni par le travail. Le pauvre est né pauvre et le restera quoi qu’il fasse. Quand on est paysan, on est marié à la terre, de sa naissance jusqu’à sa mort. D’abord dessus, ensuite dessous ! C’est aussi simple que ça !
« S’élever au-dessus de sa condition, c’est « péter plus haut que son cul », avait-elle de tout temps rabâché, surtout pour une fille ! À quoi ça sert, puisque tu vas te marier, et que ton mari ne voudra pas d’une femme instruite. Avec tes airs prétentieux, tu voudras tout le temps le remettre à sa place, et ça, y a pas un homme qui le supportera ! »
En se remémorant ces paroles, la jeune femme doit convenir que sa mère avait vu juste : à presque trente ans, elle n’a pas de mari. Et aucune envie de penser à cela maintenant !
Le temps aidant, sa mère finit par se raisonner.
– Il faut que tu aies un bon métier Lisbeth, disait-elle, Tu n’as pas le choix ! Qu’est-ce qu’il fera, quand on n’sera plus là, si tu n’as pas de quoi le nourrir ?
Tous les regards convergeaient alors vers le petit Charles, assis au pied du banc de coin de la cuisine. Sur les lattes du plancher, il manipulait des petits bonshommes de tissus et de bois, qui ne ressemblaient à rien, mais qui, dans son esprit juvénile, lui racontaient mille histoires. Concentré sur de fausses batailles, il agitait devant lui ses poupées. Sa bouche aux lèvres humides imitait le bruit des déflagrations et des coups. Son épaisse mèche blonde cachait son front et ses yeux. Mais les cheveux ras sur les tempes laissaient voir de grandes oreilles décollées. De la morve avait séché sur sa lèvre supérieure.
D’avoir vu la fatigue croître en un réseau de rides sur le visage buriné du père, de ne plus posséder qu’un lointain et vague souvenir d’un sourire animant celui de la mère, puis de porter le fardeau de la constante présence de Charles, de l’attention qu’il demandait à longueur de temps, tout cela avait forgé sa volonté de sortir à tout prix de cet état d’esclavage que leur condition avait imposé à ses parents.
Elle s’était destinée à réussir pour leur offrir d’autres rêves. Et cette volonté passait par le refus obstiné de se laisser submerger par le spectacle quotidien de leur soumission et leur servilité. Rester droite et forte pour dévier de cette route que leur misère lui avait tracée.
Et sans doute devait-elle également ce tempérament au fait d’avoir été la sœur de Charles.
Lorsqu’elle obtint son certificat d’études, son père, qui ne demandait jamais rien pour lui-même, n’hésita pas à solliciter le soutien de son voisin, le docteur Katz, pour permettre à sa fille de suivre des études à l’école normale de Strasbourg. Que sa fille puisse devenir institutrice le récompensait de sa vie de journalier. Le docteur Katz, le cœur sur la main, trouva une lointaine cousine pour héberger la jeune fille à peu de frais et contribua à financer ses études.
Trop heureuse de pouvoir enfin fuir cette vie courbée et le spectacle du sacrifice quotidien, Élisabeth partit à la capitale alsacienne à la fin du mois d’août 1939, comme on conquiert le monde : avec un appétit d’ogre, une faim de tout, le regard fixé sur la ligne d’horizon et délesté du poids du passé. Que lui importaient, alors, les privations parentales, une amourette insignifiante et l’abandon de ce frère qui n’était qu’un de ces lests ?
Et voilà qu’elle était revenue après dix ans d’absence, de silence et de mensonges. Certes, elle avait réussi, elle était devenue institutrice. Mais cette réussite ne suffisait pas à atténuer le sentiment de malaise qu’elle avait éprouvé depuis qu’elle avait pris la décision de rentrer.
Il avait fallu quelques jours aux uns et aux autres pour s’habituer à la promiscuité dans la petite maison où les habitudes de ses parents s’avéraient plus solides que les murs. Ce n’était que la nuit, une fois la mère couchée, que le père et la fille avaient tenté de maladroits rapprochements. Ils avaient tous deux mille questions en tête, mais aucun mot assez puissant pour taillader leur pudeur. Alors, ils s’étaient réfugiés derrière des généralités, des récits d’exil et de perte, tournant autour de leurs vies comme une chèvre à un pieu dans la crainte d’une éventuelle attaque. Et ce long travail de liens retissés, au fil des jours et des mots, il n’avait fallu qu’un instant et un accroc pour définitivement l’effilocher, le déchirer.
Le matin même, dans ce hall de gare, au milieu d’une foule colorée et joyeuse, Élisabeth s’était violemment pincé l’avant-bras pour ressentir enfin la douleur. Sans doute avait-elle mortellement touché son père en lui avouant l’inavouable, mais son besoin de crier la vérité avait submergé les digues de ses émotions jusqu’alors consciencieusement canalisées. Elle n’avait pas réfléchi à l’impact de son récit sur la seule personne qu’elle avait à cœur de ménager.
Élisabeth avait appris à contrôler son esprit sans jamais se laisser gouverner par les émotions, dans son monde de mots et de papiers, d’hypothèses et de déductions, entre les calculs et la grammaire. Petite, elle avait choisi de ne plus ni voir ni entendre ce qui pouvait la dévier de son chemin. Devenue adulte, elle avait totalement intégré cette indifférence aux choses, cette distance aux êtres, jusqu’au jour où ce qui était en vérité une protection vola en éclats.
Mais elle seule le sait. Pour les autres, elle apparaît encore, malgré ce cataclysme intérieur, comme une personne froide et indifférente ! C’est certainement ainsi que la juge dorénavant son père, pour une fois en accord avec sa femme qui lui en avait fait reproche quelques jours avant son départ. Froide ! Indifférente ! Égoïste !
Je n’aurais pas dû ! J’aurais dû garder pour moi ce que je savais depuis si longtemps et qui n’était même pas un poids puisqu’il n’a jamais ralenti ma route. Alors, pourquoi m’en défaire aux pieds de mon père, pourquoi avoir vidé mon sac alors qu’il n’a plus la force de porter une autre souffrance ? Je n’ai pensé qu’à moi, poussée par cet orgueilleux besoin de me justifier ou d’avoir constamment le dernier mot.
« Tu es un glaçon », s’était-elle répétée, assise dans ce vaste hall où les voyageurs pressés lui apparaissaient sous forme de vagues silhouettes bigarrées. Elle n’avait jamais su donner, incapable d’éprouver de la compassion à l’égard d’autrui, fut-il son frère. Elle avait constamment fait passer ses propres désirs avant ceux des autres, dont elle ignorait, d’ailleurs, qu’ils pouvaient en avoir. Avoir d’autres rêves, d’autres idées, d’autres combats ? Le mépris pour tout ce qui était hors de sa bulle, voilà ce qu’elle avait toujours éprouvé !
Elle se le dit tant et si bien qu’elle en obtint enfin des larmes, dissimulées aussitôt derrière des lunettes de soleil qui lui mangeaient tout le visage. Elle les accepta comme une preuve qu’elle n’était pas si monstrueuse que ça. Ce constat lui fit tant de bien que d’autres larmes affluèrent, ravagèrent ce minois si soigné comme un fleuve en crue ravine le sol pour se frayer un chemin.
C’étaient des larmes de fond qui émanaient des origines de sa peine, la remuaient tout entière pour la laisser, vacillante et hagarde, le nez dans son mouchoir, seule au milieu de la foule de midi qui s’agglutinait à l’unique guichet.
Ce ne fut qu’au sortir de la gare, pendant qu’elle attendait de monter dans l’autocar, qu’elle remarqua les rues en pente et les toits décalés des maisons étroites. Obnubilée par ses pensées, elle n’y avait guère prêté jusqu’alors attention. Mais en regardant autour d’elle, elle avait alors reconnu, dans cette ville construite sur une colline, celle figurant sur une des cartes postales que ce Monsieur Fisch avait envoyées à ses parents. Aussi monta-t-elle dans l’autocar le cœur plus léger : cette vision lui avait rappelé ce pourquoi elle était là, dans cette petite ville au fin fond d’une région qu’elle ne connaissait pas.
Maintenant, elle essaye de se faire oublier du regard scrutateur du chauffeur en se recroquevillant sur son siège et priant pour que la vieille dame l’occupe tout du long du trajet qui la mènera dans le village où se perdent les traces de Charles.
Charles avait de grands yeux clairs bordés de longs cils de fille, un charmant nez en trompette parsemé de quelques taches de rousseur dont se moquaient, entre autres, les autres enfants. Il aurait été beau, sans son air stupide, ses abyssales absences qui laissaient le vide sourdre sous ses lourdes paupières, des yeux sans fond, un air sans expression, une bouche béante sur des dents de lapin, avec de la salive, épaisse et bouillonnante, qui coulait sur le menton. Les traits d’un enfant sans attrait. Le rire d’un enfant sans sourire, qui déferlait sans prévenir en cascade tonitruante et glacée. Avec, comme seule préoccupation, celle de l’instant présent : manger et boire, jouer puis dormir, et parfois, parce que le père aime son fils et le garde dans son ombre, faire comme lui, et se courber sur les épis, les botter, les hisser sur une carriole, puis s’allonger dans la paille ; butter les rangs de pommes de terre avant de bouter les Prussiens hors de France, allongé dans la terre vorace des champs, en rêvant de champs de bataille. Et s’endormir sous les feux du soleil comme on quitte la vie sous les feux du canon.
Charles, mon frère…
Élisabeth réprime un frisson. Le rappel de la honte qui glisse le long de son échine telle une caresse obscène, jusqu’à l’écorcher.
Cette honte infâme que ses souvenirs ont, en bons chasseurs, levée comme un lièvre.
2
À l’avant du bus, la vieille dame et le chauffeur se racontent leurs guerres, elle, du côté creux de l’estomac, lui, du trop-plein d’exilés arrachés à leur terre de la plaine du Rhin, qu’Élisabeth connaît si bien. Elle se remémore alors le récit que son père lui en a fait.
Il lui avait raconté ce premier jour de septembre où toutes les cloches de tous les clochers d’Alsace et d’ailleurs se mirent brusquement à sonner en branle pour les alerter de l’imminence de la guerre.
Il décrivit la panique qui saisit les habitants dans les heures qui suivirent : il leur fallait évacuer leurs maisons, abandonner leurs bêtes et leurs champs sur le champ.
Comment savoir de quoi ils auraient besoin, dans cette France à la frange de laquelle ils connaissaient les caprices des saisons, le chemin de l’eau, la souplesse de la terre, le rythme de la vie ? Cette France de l’Extérieur, de leur pays du bord de guerre où ils étaient néanmoins chez eux !
Ils avaient eu droit à trente kilos de bagages par personne et à vingt-quatre heures pour trier l’utile du futile, garder le nécessaire et sacrifier les souvenirs. À ceux qui, obstinés, refusaient de quitter leurs terres, le docteur Katz qui remplaçait le maire défaillant, avait promis qu’une commission de sauvegarde surveillerait leurs biens. Il les rassura : tout était prévu pour les accueillir à Périgueux, Bergerac, il ne savait pas lui-même, le temps qu’on arrange leur retour. Combien de temps ? Il ne le savait pas davantage.
Après plusieurs jours d’un voyage éreintant, ils étaient parvenus dans des villes blanches et sèches, dans cette patrie d’accueil en rien préparée à une telle affluence de déracinés. Ils avaient passé plusieurs nuits dans la paille des granges, dans des greniers étouffants, avant de rejoindre un village perché dans la rocaille, éloigné de tout. C’était un hameau fantomatique, abandonné, dans lequel les avaient précédés des réfugiés espagnols. Par milliers, les républicains, qui avaient fui la dictature de Franco, avaient pris racine dans cette terre désolée, qu’ils avaient enrichie de leur sueur et de leur force. Ils avaient l’avantage de partager une langue occitane que les gens du cru comprenaient, si bien que leur arrivée massive eût posé moins de problèmes que celle des Ya-Ya.
« C’est comme ça qu’on nous surnommait ! confia le père d’Élisabeth avec une pointe d’agacement. Les gens ne comprenaient pas notre dialecte et nous prenaient pour des Boches.
Est-ce notre faute, à nous Alsaciens, si la France et l’Allemagne se sont sans arrêt battues pour notre sol comme deux chiffonnières ? Nous, on a parlé le Hochdeutsch depuis 1871. On a dû renier le français quand l’Allemagne nous a annexés ; ensuite, ce sont les Français, après la victoire de 18, qui ont refusé qu’on s’exprime en allemand.
Tout ce qui nous restait, dans notre exil, c’était l’alsacien, notre langue maternelle. Qu’on soit du nord ou du sud de l’Alsace, notre patois représente notre identité. Il charrie, pareil à une rivière en crue, des gros mots et des tournures qui ne seraient pas drôles ailleurs que dans ce lit. Mais bon, je comprends ces gens : ça résonnait à leurs oreilles comme la langue de l’ennemi contre qui leurs fils ou leurs maris allaient se battre. C’était pour eux à n’y rien comprendre, que le gouvernement leur demande d’héberger ces presque Boches sous leurs toits. À y perdre leur latin ! »
Monsieur Muller décrivit les semaines puis les mois durant lesquels ils remontèrent, au fil à plomb, les murs du village ruiné, et firent tomber, au fil des jours, les murs de la défiance. À force de labeur et de patience, parce que leur réputation de travailleur s’étendait désormais bien au-delà du hameau perché dans les roches couvertes de lichen, ils parvinrent à lier le ciment entre les communautés.
Ils finirent par s’adapter, notamment grâce au curé de Sarlat-la-Canéda qui était tout heureux de cet afflux de pratiquants dans ce pays d’Oc où Dieu n’était pas en terre conquise. Il enviait le Concordat, l’enseignement privé et religieux, le salaire des prêtres, lui dont le sort dépendait entièrement de la générosité de ses paroissiens.
« D’après lui, en plus de notre jargon, les gens supportaient difficilement notre attitude : ils disaient qu’on avait l’air hautain, qu’on critiquait constamment leur mode de vie rudimentaire. C’est vrai que ce n’était pas très malin de notre part de nous vanter devant eux du confort de nos maisons et de nos villages, mais on avait eu l’impression, en arrivant là-bas, de faire un bond en arrière vers le Moyen-Âge. En plus, quand on leur expliquait qu’on devait l’eau courante et l’électricité dans nos maisons aux Allemands, ils se mettaient dans de terribles colères et nous tournaient le dos. Et je le comprends !
« Le jeune Léonard, le protégé du curé Abt, a un jour été pris à partie par des jeunes gens de son âge qui prétendaient qu’on les traitait d’arriérés. Il a alors calmement expliqué la façon dont l’Alsace, sous le Reichsland, s’était modernisée.
– Quand je disais que vous êtes des Boches ! s’est fâché l’un d’eux, t’en parles avec trop de nostalgie pour être à cent pour cent français ! Venez, les gars ! Ça pue le Frisé, ici !
Personne ne l’a suivi. Quelques-uns ont hésité mais le chef de la bande a tendu la main à Léonard, en lui lançant d’une voix forte « Bienvenu parmi nous, Léo ! ».
Léonard s’était fait de nouveaux amis. »
Malgré une lente adaptation aux lieux et aux gens, le Heimweh, le mal du pays, avait rongé leur âme comme l’humidité les vieux murs de pierres branlantes. À l’affût des nouvelles de leur terre de l’Est, alors que l’hiver s’infiltrait sous les portes et aux jointures des pierres, sur les hauteurs venteuses où ils s’acharnaient à vivre, ils apprirent par la TSF les saccages et les pillages auxquels se livrait, dans leurs maisons abandonnées, la soldatesque française, censée garder la Ligne Maginot.
« C’était en novembre, je crois. Il faisait un froid de canard en cet hiver 39 »
Quand j’en ai parlé à Seppi, il est devenu blême. J’ai cru qu’il allait nous lâcher d’un coup. Des grosses larmes sont sorties de ses yeux à la vitesse d’un compte-gouttes. Stoïque, son épouse était restée debout dans son dos, ses mains aux doigts gercés posées sur ses épaules.
– Dès que je peux, j’y retourne ! qu’il a dit avec des lueurs de tueur dans les yeux, on peut même pas accuser les Allemands, puisqu’ils n’ont pas encore attaqué ! Chiens de Français ! Putain de soldats ! Dès que je peux, je rentre chez moi !
Le préfet nous avait laissé le choix : rester dans le Périgord ou retourner en Alsace. Quelques-uns de Kleinheim, notamment les plus jeunes, ont préféré rester en territoire occitan : leurs racines alsaciennes étaient moins profondément plantées que les nôtres. Comme Léonard, le protégé du curé Abt, qui était revenu en même temps que nous à Kleinheim. Dégoûté par cette autre Alsace, il est directement reparti. Un an après la guerre, il s’est installé au village avec femme et bagages, et se vante depuis de toutes les misères qu’il a faites aux Boches avec ses amis maquisards.
On a quitté Bergerac dans les derniers jours de juillet 1940.
L’Alsace était allemande depuis la mi-juin. Paris était occupé depuis le 14.
Les Allemands étaient partout comme chez eux, du moins les délégués de la Croix Rouge allemande, qui circulaient sans contrainte en zone libre, pour inciter les réfugiés alsaciens à retourner au pays ! Les soldats allemands portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Vous pouvez rentrer chez vous »
Il parla enfin de leur retour sur le sol natal en août 1940, ce « chez vous » qui appartenait dorénavant à d’autres, cette terre que l’occupant s’était appropriée sans vergogne ni pudeur, au point d’en avoir réécrit chaque enseigne commerciale, le moindre lieu-dit, jusqu’aux commodités planquées au fond des jardins. Tout se lisait désormais en langue allemande. Leur terre était marquée du sceau gothique telle une bête rétive dont a croupe porte le fer de son maître.
Élisabeth avait écouté le récit de son père sans l’interrompre, mais un regard vers la maison voisine, sa façade vert pâle, aux persiennes rabattues, aviva sa curiosité :
– Qu’est devenu le docteur Katz ?
Son père avait baissé les yeux.
« Quand l’état-major allemand a réquisitionné sa maison après son expulsion, courant 1940, le premier travail des Boches a été d’embarquer les toiles, soigneusement protégées avec ses draps les plus soyeux, dans un camion bâché en direction de la frontière.
Bref, le Dr Katz, tu l’as compris, n’est pas parti de son plein gré. Ils l’ont embarqué en août 1940 avec moins de ménagement que ses tableaux. Lui aussi, il était dans de beaux draps !
– Tous mes biens sont désormais devenus des « biens ennemis », qu’il m’a dit. Eh oui, mon cher ami, le juif est devenu la mauvaise herbe à déraciner, mais tout comme les partis politiques, les loges maçonniques, les Français installés après 1918, j’en passe… Tous voient leurs biens confisqués. Pour les nazis, tout est bon à prendre !
La dernière fois que je l’ai vu, il embarquait à l’arrière d’un camion bâché, avec tout ce que les Allemands avaient pu ramasser comme rebut de leur société.
La vieille Hortense, sa bonne, nous a envoyé une carte postale de Paris en 1945 ou 46. Elle y disait qu’elle allait tous les jours au Lutécia dans l’espoir de retrouver une trace du docteur Katz. Elle disait que même lire son nom dans une liste aurait été préférable à cette attente. J’ignore si ses espoirs ont été récompensés, ou s’ils sont partis en fumée, quelque part dans le ciel de Dachau ou de Treblinka. »
« L’histoire se répète, avait dit son père après un long silence, c’est la valse des expulsions qu’entonne chaque nation victorieuse : en 1919, l’ancien propriétaire de la villa, d’origine allemande, avait été expulsé manu militari par les Français, après avoir vécu là pendant près de trente ans. Rebelote avec le bon docteur chassé par les Boches. La dernière guerre avait à nouveau brouillé les cartes, avait changé la donne dans ce jeu de bataille, dont le docteur Katz a été un des perdants. »
Le père avait tout dit ou presque. Son voyage dans le temps avait fait le ménage dans ses souvenirs, si bien que la place était libre pour faire surgir l’essentiel : le sort de Charles. Mais à cela, ni le père ni la fille ne s’y résolvait. Lorsque, par inadvertance, leurs regards se portaient sur la chaise vide, une gêne presque palpable les prenait, les poussant l’un et l’autre à discourir de banalités.
3
Des jours passèrent pendant lesquels la mère d’Élisabeth l’épiait d’un air mauvais. Elle poussait de profonds soupirs en fixant la chaise vide en bout de table durant les repas, sans ouvrir la bouche autrement que pour commander son mari. Et puis, un soir, n’y tenant plus, elle lança :
– Bon, ça suffit ! Il faut qu’on cause !
Élisabeth se sentit brusquement défaillir : l’heure était venue, pour elle, de passer à table. Après dix années de séparation, la curiosité de ses parents à son endroit était légitime, mais elle n’avait aucune envie de parler d’elle. Tandis qu’elle rangeait les assiettes dans le vaisselier, son esprit pragmatique envisageait toutes les questions que ses parents ne manqueraient pas de lui poser, et les réponses qui allaient avec, le tout dans un paquet bien emballé. Mais ce qu’elle n’avait pas prévu, elle qui avait pour habitude de tout contrôler, c’était que sa vie n’était pas au centre des préoccupations maternelles.
Aussi fut-elle soulagée quand sa mère précisa :
– Faut qu’on parle de Charles ! Montre-lui !
Le père ouvrit une boîte métallique qu’il avait cherchée dans leur chambre à coucher. Élisabeth la connaissait, cette ancienne boîte à gâteaux dans laquelle ses parents rangeaient leur trésor : les papiers importants, les rares lettres ou cartes postales, des vieilles photographies d’aïeux prises devant des tentures rococos dans un cabinet de la grande ville, des breloques, médailles, souvenirs de communions ou de mariage, cartes de condoléances…
Depuis le temps, la boîte n’était toujours pas pleine, et de son contenu émanait encore un parfum de petits-beurre.
Élisabeth en fut attristée. Elle mesura l’indigence de leur existence, eux qui n’avaient même pas assez de souvenirs à se mettre sous la dent.
Maugréant contre les gestes lents de son mari, la mère s’empara brusquement de la boîte dont elle extirpa des papiers qu’elle glissa sous le nez de sa fille :
– Voilà, c’est tout ce qu’on a !
Élisabeth saisit d’abord la photographie. Charles y posait fièrement, en habit de communiant. Le bras droit enserré d’un bandeau, les mains crispées sur un cierge au diamètre si large qu’il avait dû incliner la tête de côté pour être vu, il riait, et la jeune femme crut entendre ce rire comme si son frère avait été dans la pièce et se moquait d’elle.
Gênée, elle déposa l’image sur la table. Sa mère la reprit et, la tenant éloignée à cause de sa presbytie, sourit à son fils.
– Ces cartes postales, on les a reçues de Monsieur Fisch, l’homme qui a hébergé ton frère à Roppensdorf, dit le père. Il écrivait environ tous les six mois.
De l’index, Élisabeth fit glisser les cartes empilées, en compta six. Elle prit celle du dessus, passa brièvement sur l’image qui représentait le profil d’une petite ville sur une colline, la retourna. Elle était datée du 9 octobre 1939.
Au crayon de papier bleu avaient été rédigées quelques lignes en français, joliment calligraphiées :
« Bonjour, ces quelques mots pour vous rassurer au sujet de votre fils Charles. Il est arrivé à Roppensdorf et loge chez moi depuis quelques jours. Il est en bonne santé, et donne des coups de main à la ferme en attendant son retour parmi vous. C’est un gentil garçon qui nous apporte, à mon épouse et à moi-même, beaucoup de joie. Il vous aime fort. »
En bas, à droite, Charles avait signé de son prénom, comme sa sœur le lui avait appris, en lettres majuscules et tremblantes de tailles différentes.
– Je ne sais pas quand cette carte est arrivée : nous ne sommes rentrés qu’en août 1940 du Sud-Ouest. Elle nous a été remise, avec le reste du courrier, par Isidore à notre retour.
– Madame Wiss et son fils habitent toujours ici ? interrogea Élisabeth, en feignant d’ignorer le regard réprobateur de sa mère.
– Toujours ! Même pendant l’exode, Madame Wiss n’a pas quitté Isidore. D’abord, il est resté pour surveiller le village. Ensuite, les Allemands avaient besoin de lui pour manœuvrer les écluses. De toute façon, il te racontera ça, lui-même.
Élisabeth sursauta et demanda pourquoi.
– C’est lui qui a aidé Charles le jour où il a disparu. Je comprends tes réticences, mais je veux que tu lui parles. Peut-être qu’il te dira, à toi, des choses qu’il a gardées pour lui.
– Que s’est-il passé exactement avec Charles ?
– Dis-lui, toi qui l’as perdu ! s’écria sa mère tout en se levant soudainement pour arpenter la pièce en fusillant son mari du regard.
« Comme je te l’ai dit, on était dans les prés à couper le regain le jour où le tocsin a retenti.
Il faisait une chaleur à crever. Pas d’air, comme si, parce qu’il avait lui aussi peur de ce qui se tramait de l’autre côté du Rhin, le ciel retenait son souffle.
Parce que je suis lent à réagir, j’ai mis longtemps avant d’imiter les autres paysans qui avaient brusquement détalé en direction du village, laissant leurs fourches derrière eux, piquées comme des croix dans un cimetière. Derrière la carriole où Seppi et moi, on hissait le foin, il n’y avait plus personne pour achever le travail.
– Tu as vu Charles ? que j’ai demandé au vieux en sautant de la charrette.
– J’crois bien qu’il a de nouveau suivi la fille !
– C’est pas vrai, ça ! Il choisit bien son moment, celui-là !
J’ai voulu me précipiter vers la forêt où je pensais qu’il avait disparu.
– Il reviendra tout seul, va ! me lança Seppi en me rejoignant au sol, viens plutôt avec moi à la mairie, qu’on sache de quoi il en retourne.
Tu connais le Joseph, il est toujours d’un calme, d’une patience ! Je l’ai suivi sans plus m’occuper de Charles, tout en râlant contre la manie de ce gosse de disparaître sans prévenir. »
– Il a suivi cette fille, là, cette rouquine qui venait tous les étés aider la famille Bloss aux travaux de la ferme, intervint la mère d’un ton revêche. On ne l’a jamais revu. On a dû quitter le village sans lui.
Madame Muller noya ses larmes dans un mouchoir. Gênée, Élisabeth regarda l’amas de papiers devant elle. Elle n’avait pas le cœur de tout lire. Elle s’empara de la dernière carte, une vue du Wirtschàft zur Traube de Roppensdorf avec, au second plan, ce qui ressemblait à une gare.
Le tampon de la Feldpost, la poste allemande, avait été appliqué à trois endroits, sur un timbre-poste à l’effigie de Hindenburg, le défunt président du Reich. Un aigle impérial déployait ses ailes sur l’adresse de ses parents, n° 111, Wilhelmstrasse, que la jeune femme connaissait sous le simple nom de rue principale. Rédigé en allemand littéraire, le Hochdeutsch, le message se résumait à cette phrase lapidaire : « Tout va bien ! »
Sans s’en apercevoir, Élisabeth avait lu ces mots à haute voix.
– Tout va bien ! Tout va bien ! Et tu crois ! s’exclama la mère. Regarde la date, elle a été postée le 14 septembre 1942. Dix jours après, ton frère était mort !
Le père couvait sa femme d’un regard inquiet, s’attendant sans doute à ce qu’elle fasse une crise de nerfs. Mais, pressée que sa fille soit au courant de toute l’histoire, celle-ci pointa, d’un index nerveux, une coupure de presse. Le papier était aussi fin qu’une dentelle, une pelure jaunâtre aux caractères en partie effacés, à force d’avoir été manipulé. L’article provenait d’un journal.
« Todesstrafe… Peine de mort requise contre des terroristes », titrait l’article en lettres gothiques. Suivait une liste de noms, dont celui de son frère, Charles Muller, souligné au crayon rouge.
– Terroristes ? demanda, éberluée, Élisabeth.
– Pour les Boches, tous ceux qui refusaient de se fondre dans le moule du National-Socialisme étaient des terroristes, précisa son père. Tout ce qu’on sait, c’est que Charles a fait partie d’un groupe de réfractaires qui a tenté de passer en Suisse, pour éviter l’Incorporation de Force dans les armées du IIIe Reich.
– Mais pourquoi ? le coupa sa fille. Il ne risquait rien avec ses problèmes, et puis, il était trop jeune, non ?
– Tu connais ton frère, répondit la mère d’une voix émue, il se sera de nouveau laissé influencer. Et puis, ses problèmes, comme tu dis, ils auraient pu lui en attirer d’autres encore pires, en ce temps-là. Tu sais quand même ce que ces salopards ont fait à ceux qui n’avaient pas toute leur tête, aux gens pas pareils que nous, non ? !
Sa mère devenait agressive. Contrôlant sa propre colère, Élisabeth regroupa les papiers sur un tas qu’elle tendit à son père.
– Non ! Garde-les. Tu n’as pas tout lu.
Son père déchira dans le journal du jour un page au milieu de laquelle il disposa les documents. Il plia soigneusement le papier autour et entoura le tout de ficelle. Il tendit le paquet à sa fille, sous le regard mauvais de son épouse.
Madame Muller épiait sa fille d’un œil noir.
– Décidément, tu n’as pas changé ! Tu t’intéresses toujours aussi peu à ton frère. On ne peut rien te demander !
– Je suis venue, non ? se fâcha la jeune femme, à bout de patience.
Elle regretta aussitôt son emportement. Elle détestait en elle toutes les manifestations de l’impulsivité maternelle, refusant de lui ressembler.
– Tu es froide comme un glaçon, surenchérit la femme, dont la voix trahit alors une montée de larmes. De toute façon, tu n’as jamais aimé ton frère ! Ce pauvre innocent… Tu as toujours été méchante avec lui ! C’est pour ça qu’il était insupportable avec toi ! Ah ! Si je n’avais pas travaillé toute la sacro-sainte journée, je m’en serais occupée moi-même, de mon petit ! Toi, à part étudier, tu ne faisais rien.
Peu encline à la tendresse, Élisabeth trouvait en effet pesant l’effort d’aimer. Rien du domaine des sentiments ne lui était familier. Elle ne savait pas, d’ailleurs, quels sentiments elle avait éprouvés à l’égard de son frère. La plupart du temps, c’était de l’ennui, de l’indifférence, et parfois, lorsqu’il venait l’attendre à la sortie de l’école, le désir de disparaître sous terre, quand les autres gosses riaient aux éclats en les montrant du doigt.
– C’est de ta faute, si Charles est mort ! geignit encore la mère. Tes satanées études ! Y avait que ça qui comptait ! Tu aurais été là, Charles n’aurait jamais suivi cette fille !
– Ça suffit ! asséna son mari qui quitta la table. Va te coucher, ça vaut mieux que de dire toutes ces bêtises !
Après un pesant silence durant lequel ils écoutaient malgré eux les pleurs dans la chambre voisine, le père d’Élisabeth éclaircit sa voix, et se lança :
– Tu as tardé à venir, je t’ai pourtant écrit plusieurs fois. Je commençais à désespérer. Tu n’as pas changé d’adresse, dis-moi ?
La jeune femme rougit violemment.
– Bien sûr que non ! Mais tu sais bien que je ne peux quitter l’école comme ça ! J’ai dû attendre les vacances scolaires.
Fernand Muller opina silencieusement, gardant pour lui que cela faisait bien cinq ans qu’il lui demandait, tous les ans, de revenir les voir, et qu’elle trouvait toujours une bonne excuse pour ne pas le faire, les rares fois où elle avait répondu à ses courriers.
– Tu te plais toujours dans ton école ?
– Oui, oui ! répondit-elle trop hâtivement à son goût, les enfants sont charmants, et le directeur de l’école fait tout pour me rendre la vie plus facile.
– Tu habites encore au-dessus de la salle de classe ?
– Oui ! Ne t’inquiète pas, papa, tout va bien.
« Tout va bien ! » N’est-ce pas ce qu’avait écrit ce Monsieur Fisch quand tout partait à vau-l’eau ?
Désireuse de changer au plus vite de sujet, elle demanda à son père de lui en dire davantage sur le sort de Charles.
– Je te l’ai dit, on ne sait pas grand-chose. Et ce qu’on sait correspond si peu à ce qu’était ton frère ! Ta mère et moi avons reçu, début octobre 1942, un courrier du camp de Vorbrück-Schirmeck qui nous annonçait l’exécution de Charles et de ses camarades, le 23 du mois précédent. Nous n’avons jamais pu récupérer ses cendres.
– Et tu veux que je le fasse ! acheva la jeune fille d’un ton assuré, comme si c’était chose facile.
– J’aimerais que ta mère puisse faire son deuil. Elle n’a nulle part où prier et tourne comme un chien à la recherche de son os. Ça la rend folle.
Élisabeth pensa « ça ne date pas d’hier » mais garda pour elle ces mots blessants qui auraient mis fin à leur complicité renaissante. Elle posa une main sur l’avant-bras de son père, dont le regard morose s’était porté vers la fenêtre et, au travers elle, sur la lune ronde comme un écu. Quand il lui proposa une promenade sous les étoiles, elle le suivit avec l’empressement d’une enfant.
Élisabeth se crispe sur son siège. Au fil des divagations, elle sent bien que l’étau se resserre pour extraire d’elle la faute commise il y a peu. Alors, elle résiste, jette un coup d’œil autour d’elle comme un noyé sonde l’eau tumultueuse en vue d’un frêle esquif auquel s’accrocher. Mais c’est l’œil fixe du chauffeur de car qu’elle croise dans le rétroviseur, un œil rond qui la scrute, l’étudie tandis que, l’air de rien, il échange ses souvenirs de guerre avec la vieille dame. Élisabeth se recroqueville sur son siège, passe une main sur ses cheveux dont elle rectifie la chienne et le foulard. Elle s’oblige à détourner le regard. Les collines se succèdent au rythme lent de l’autocar. Par la fenêtre ouverte s’infiltre l’odeur des gaz d’échappement.
Élisabeth se souvient de l’odeur des foins fraîchement coupés qui embaumaient l’air encore tiède, le soir de sa promenade en compagnie de son père.
En quittant la rue principale, le père et la fille s’étaient inconsciemment accordés sur leur destination : la maison du canal, où ils avaient vécu jusqu’à l’incendie. Dans le prolongement de celle de l’éclusier, subsistaient quelques murs. Des ronces s’enroulaient dans l’ancien salon, des rejetons d’érable poussaient là où s’élevait l’échelle de meunier, et une glycine avait choisi les briques creuses pour tracer la route sinueuse de son tronc.
– Tu te souviens ? Je voulais reconstruire, mais je n’ai pas eu le droit à cause de la Ligne Maginot.
La voix de son père monta comme un orage lointain, l’orage violent d’un mois d’août de l’enfance, quand l’eau avait tout raviné sur son passage ; le ciel éclairé comme en plein jour par cette succession d’éclairs, et la foudre… La foudre tombée là, comme si le doigt de Dieu désignait leur maison, comme si ce doigt montrait la petite pièce sous les combles, et l’enfant, tout petit, innocent, qui y dormait.
– J’y dormais aussi !
– Je sais, mais tu as eu plus de chance !
Il raconta le hurlement de Charles, la chute de Charles, du plancher de l’étage à celui de la Stuwa, la pièce à vivre. Il raconta le feu qui prit sous le toit, alors qu’il était penché sur son fils dont la peau sentait le cochon brûlé, les cris de la mère qui saisit l’enfant dans ses bras pour l’allonger dans l’herbe humide de la berge. Il décrivit la chaîne humaine de l’eau du canal aux murs léchés par les flammes ; il vit les affaires d’une vie jetées pêle-mêle sur la terre gorgée de flaques du chemin, et son seul manteau d’hiver, le temps que les eaux noires du canal l’avalent.
Sa femme ne savait comment enlacer cet enfant, avec son dos aux chairs calcinées. Autour du corps de Charles, on a rameuté toute l’aide possible. Le Docteur Katz est là. Il regarde l’enfant, il regarde autour de lui, l’eau du canal, l’eau des flaques, l’eau des murs ; il voit que tout est noir et sale, et il dit à Monsieur Muller : « Venez chez moi ! »
– Et moi, j’étais où ? l’interrompit sa fille, dépitée. À t’entendre, on dirait que je n’étais même pas là !
– Toi, toi ? Toujours toi ! s’énerva brusquement le père en se dégageant de l’emprise de sa fille. Je vais finir par croire ta mère quand elle prétend que tu n’es qu’une égoïste ! Tu veux vraiment savoir ce que tu faisais ? Eh bien, tu pleurais. Tu te lamentais parce que tous tes livres avaient brûlé, ton livre d’école, tes craies, ton ardoise, ta blouse et ton sac, tout avait brûlé. Tu hurlais à fendre l’âme, tu trépignais de colère : il a fallu t’arracher aux flammes tellement tu restais cramponnée à tes affaires. Pendant ce temps, ton petit frère était mourant, c’est du moins ce que j’ai cru, ce que ta mère a cru. Mourant ! Toi, tu…
– Arrête !
Élisabeth s’était placée sur le chemin de son père, le forçant à la regarder.
– Tu as raison, je ne suis pas fière de moi, mais les livres, c’était tout ce que j’avais. J’étais une enfant et…
– Dis plutôt que c’était tout ce que tu aimais, oui, ce serait plus juste !
– Oh ! Je t’en prie, épargne-moi le discours de maman, qui prétend que je n’aime pas Charles. Charles n’était pas un enfant ordinaire. Il était difficile, pour moi, de devoir toujours m’en occuper, de veiller à ce qu’il ne fasse pas de bêtises, pendant que vous étiez au travail. Je te rappelle que tu voulais que j’étudie. Alors, ne me reproche pas de lui avoir consacré trop peu de temps !
– Ton frère n’a pas toujours été difficile ! Il était normal, avant l’accident.
– Non ! réagit la jeune femme, c’est faux, Charles n’a jamais été normal ! Et tu le sais !
Face au regard ébahi de son père, Élisabeth regretta de s’être ainsi emportée. Elle s’en voulut, par son viscéral besoin de donner raison à la vérité, surtout lorsque celle-ci la sert, d’avoir gâché ce moment où ils se rapprochaient. Mais il était trop tard pour rattraper ses mots, car son père, malgré son accablement, l’épiait d’un air interrogateur et résolu.
– Je ne te l’ai jamais dit, mais j’ai toujours pensé que tu le savais, commença-t-elle doucement. Quand Charles est né…